
Inspecteur général des monuments historiques à la vielle de la guerre, Jean Verrier, est surtout connu pour avoir fait mettre à l’abri en 1939 les vitraux des plus prestigieux édifices religieux menacés par les bombardements.
Dans son article publié fin 1951 dans la revue Techniques & Architecture, il souligne, exemples à l’appui, le rôle du Service des Monuments Historiques face aux urbanistes et aux architectes du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme.
« Il est une série de questions qui revêtent, du fait des destructions de guerre, une importance toute particulière ; ce sont celles qui intéressent les bâtiments anciens dans la cité, soit que ces monuments aient à s’incorporer dans des quartiers entièrement neufs, soit que ces édifices forment eux-mêmes un quartier ou simplement un ensemble que l’on ne saurait négliger.
A cet égard, la législation, en donnant sous certaines conditions un droit de regard au Service des Monuments Historiques sur toutes les constructions dans un rayon de 500 mètres des édifices classés, permet très utilement d’intervenir et même d’imposer parfois des solutions qui préservent le voisinage des édifices contre des constructions préjudiciables à ces édifices, soit par leur volume, soit par leurs matériaux et leurs couleurs.Aussi bien les études des plans de ville, faites au cours des dernières années, ont-elles tenu compte de ces obligations légales et des liaisons nécessaires sans cesse plus intimes se sont-elles faites entre les architectes urbanistes et les architectes des Monuments Historiques tandis qu’à l’échelon ministériel l’Inspection Générale des deux services s’efforçait d’assurer une communauté de vue dont en définitive les monuments de France devaient profiter.
La Ville de Saint-Lô est, on le sait, une des cités qui ont le plus souffert dans leur totalité. Plus de 80% des immeubles ont été détruits ; rien des quelques maisons anciennes qui, de-ci delà, donnaient à la ville un certain caractère, n’a subsisté. La cathédrale elle-même, au sommet de la colline sur laquelle était construite Saint-Lô, a été terriblement endommagée.
Si le chœur et quelques travées de la nef n’ont pas été gravement atteints et sont d’ores et déjà à peu près remis en état, la façade occidentale et les deux tours que surmontaient d’élégantes flèches de pierre, sont aux trois-quarts détruites. Le monument subsiste néanmoins et sans préjuger de ce qui sera fait pour sa façade et les tours, c’est ce monument qui commande l’urbanisation de tout le centre de la ville ; c’est en fonction de sa masse, de sa valeur architecturale, que seront tracées les voies et leur largeur ; que le volume des constructions les plus voisines sera arrêtée, on ne saurait admettre qu’un tel édifice dans une ville de faible importance, à l’industrie peu développée, ne soit pas le noyau d’attraction du développement urbain.
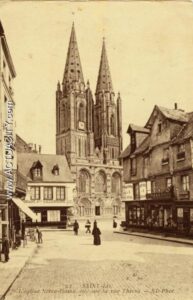


« A Rouen, le problème était bien différent ; vaste cité industrielle et commerçante, tout le quartier entre le côté Sud de la cathédrale et la Seine a été complètement détruit, dégageant à l’excès un édifice du Moyen-Âge qui, on l’a dit bien souvent, ne doit pas être dégagé par de vastes perspectives qui lui feraient perdre toute échelle, mais au contraire être comme enserrée dans des constructions rapprochées qui laissent découvrir les aspects divers de l’architecture médiévale.
C’est ainsi qu’on s’est gardé, dans les projets en cours d’exécution, et malgré certaines oppositions initiales, de créer ou une place ou une voie large le long du flanc Sud de la cathédrale. Celle-ci, nécessaire à la circulation d’une ville de commerce comme Rouen, a été reportée de quelques dizaines de mètres plus au Sud, laissant subsister des groupes d’immeubles de hauteur modérée entre la rue longeant la cathédrale et cette nouvelle voie.
C’est ainsi également qu’on n’apporte aucune modification aux rues étroites et tortueuses qui, au Nord et au chevet de la cathédrale et autour de l’église Saint-Maclou, conservant à Rouen un peu de son caractère de ville du Moyen-Âge, comme on conserve également, autant que faire se peut, son aspect à la rue du Gros-Horloge, comme au Palais de Justice, et à ses alentours immédiats.
A Rouen, les monuments ne pouvaient commander l’urbanisation de la ville, les besoins de la circulation et du trafic commercial exigeaient des solutions moins strictes, mais les monuments conserveront un cadre ou verront se construire auprès d’eux des immeubles que ni nuiront pas à leur aspect ».
En échos au constat fait par Jean Verrier en 1951, voici ce qu’écrit Patrice Pusateri en 2013 : « Le quartier situé entre la cathédrale et la Seine, très surveillé par le service des monuments historiques, a fait l’objet d’une recherche attentive des architectes en chef de la reconstruction : tracé des rues élargi sans exagération ; rétrécissement progressif de la rue Grand-Pont jusqu’à son contact avec le Bureau des finances, bel édifice Renaissance épargné par la guerre ; création d’une nouvelle rue dans l’axe de la tour de Beurre, au tracé légèrement sinueux, et aux décrochements volumétriques subtils ; nouvel axe oblique créé en prolongement de la rue Alsace-Lorraine (la rue du Général-Leclerc), dégageant des volumes d’angle dynamiques, comme les Galeries Lafayette ».
Voici ce qu’écrivait Jean Verrier en 1951 à propos du chef-lieu de l’Eure : « Sans quitter la Normandie, si nous examinons les problèmes qui se posaient à Évreux, nous verrons que des principes analogues à ceux que nous venons d’exposer, ont guidé les architectes chargés de la reconstruction de cette ville dont les deux rues principales se coupent à angle droit, la Rue Grande et la Rue Chartraine, étaient bordées d’immeubles médiocres et sans grand caractère, dont la presque totalité a été détruite. La belle cathédrale gothique assez gravement atteinte dans sa partie Ouest, a conservé son cadre des jardins étroits de l’évêché du XVème siècle qui subsiste intact. L’ancien beffroi, du XVème siècle lui aussi, était assez sottement isolé sur la place de l’Hôtel de Ville, pompeux et médiocre comme le théâtre et le musée qui occupent les autres côtés de la place. La destruction des maisons voisines a découvert des fragments assez importants de la muraille gallo-romaine, ainsi que le cours de l’Iton qui arrose la ville et servait d’égout en partie couvert.
Très habilement, l’architecte reconstructeur a raccroché le beffroi à un groupe d’immeubles de volume modéré qui le met en valeur sans l’étouffer ; il a créé une promenade sinueuse pour piétons le long de l’Iton, désormais découvert et nettoyé, depuis la cathédrale jusqu’à l’Hôtel de Ville, longeant la muraille gallo-romaine, là où elle subsiste encore.
Les murs ont vu leur tracé rectifié, non pour en faire des voies droites et monotones, mais en leur donnant certaines inflexions qui les lient davantage à la petite rivière ; les immeubles qui les bordent ont été étudiés dans leur volume comme dans leurs matériaux et en pentes de leurs toitures pour créer un ensemble varié an abus du pittoresque.
A Évreux, ce n’est donc pas un seul monument qui a imposé l’urbanisation, c’est une compréhension de l’intérêt des monuments ou des vestiges anciens qui est à l’origine d’une amélioration sensible sur les dispositions et les constructions urbaines du XIXème siècle ».

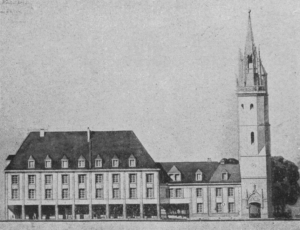

A Strasbourg, autre aspect encore des problèmes que pose le respect des monuments anciens. Les destructions y sont nombreuses, très nombreuses même, car bien peu de rues ont été épargnées ; mais ces destructions ne sont pas massives sur tout un quartier, comme dans les villes que nous venons de citer.
Dans beaucoup de voies, c’est une, deux ou plusieurs maisons détruites formant des brèches répétées dans ces rues où abondent les hôtels du XVIIème ou du XVIIIème siècle.
Dans ce cas, on ne saurait imposer, comme il a fallu le faire à Orléans dans la Rue Royale où l’architecture ordonnée exige une continuité, un pastiche de style ancien qui n’est plus de mise ; mais c’est dans la hauteur, le volume des constructions, le mode de couvertures et leurs pentes, la couleur des matériaux beaucoup plus que dans la forme des ouvertures, qu’il est nécessaire d’imposer aux constructeurs des limitations de leur liberté, celles-ci permettant de conserver aux rues de Strasbourg une harmonie qui avait été si heureusement respecter au cours des siècles précédents.
On ne saurait trop regretter les constructions minables élevées après la guerre de 1914-1918, sur la place de la cathédrale de Reims et le volume même de cette place, trop vaste, tout comme le parvis de Notre-Dame à Paris, pour ne pas s’être efforcé à Amiens où les destructions de guerre ont fait disparaître tous les immeubles plantés à l’Ouest de l’édifice, de créer un parvis suffisamment resserré, et bordé de constructions d’une hauteur assez réduite pour que la cathédrale gothique et sa façade reprennent toute leur échelle et leur valeur architecturale.
Ceci est un des cas où le monument impose impérativement des solutions qui peuvent être en contradiction avec les règlements de voirie autorisant de plus grandes hauteurs.On a souvent parlé du dégagement des édifices, et en général fort mal à propos ; sans aller jusqu’à une servile imitation du Moyen-Âge qui n’hésitait pas parfois à laisser adosser à des églises des maisons ou des échoppes – ce serait du mauvais pittoresque – il ne faut jamais perdre de vue que l’entourage d’une église du Moyen-Âge doit être restreint. Ce fait pourra se vérifier une nouvelle fois à Amiens, si, comme on est en droit de l’espérer, l’architecture des constructions modernes qui vont s’élever autour de la cathédrale, est de qualité.
Nous ne saurions multiplier ces exemples ; ils suffiront à montrer quelques-uns des problèmes que les Agents du Service des Monuments Historiques ont à résoudre. Bien souvent, les sujétions qu’ils ont à faire admettre soulèvent, on le comprend aisément, des oppositions d’autant plus vives qu’elles heurtent des intérêts généraux comme de intérêts privés. Mais l’action continue qui est ainsi exercée a déjà produit à maintes reprises les plus heureux résultats. Nous pensons avoir fait œuvre utile, en faisant mieux connaître à un public averti comme celui de cette revue, les principes qui guident cette action et qui tendent avant tout à conserver à notre pays l’harmonie architecturale qui s’allie si souvent à l’harmonie varié de ses paysages ou de ses sites urbaines.
Jean VERRIER aurait pu mentionner le cas de la reconstruction du Saint-Malo ‘’intra-muros’’ qui relève plus d’une reconstitution illusionniste que d’une reconstruction à l’identique.
Compte tenu de l’ampleur des destructions, le parcellaire de cette ville fortifiée a été profondément modifié puisque le nombre des parcelles a été réduit de plus de mille à moins de trois cents et le nombre d’îlots sensiblement réduit.
Seuls, les 24 immeubles de la façade sud, dites ‘’les maisons des corsaires’’, protégés par les Monuments historiques ont vu leurs façades recontruites à l’identique. Les autres immeubles ont été reconstruits en respectant les servitudes posées par les Monuments historiques et en s’inspirant de la trame définie par Louis Arretche, l’architecte-en-chef.
JLV